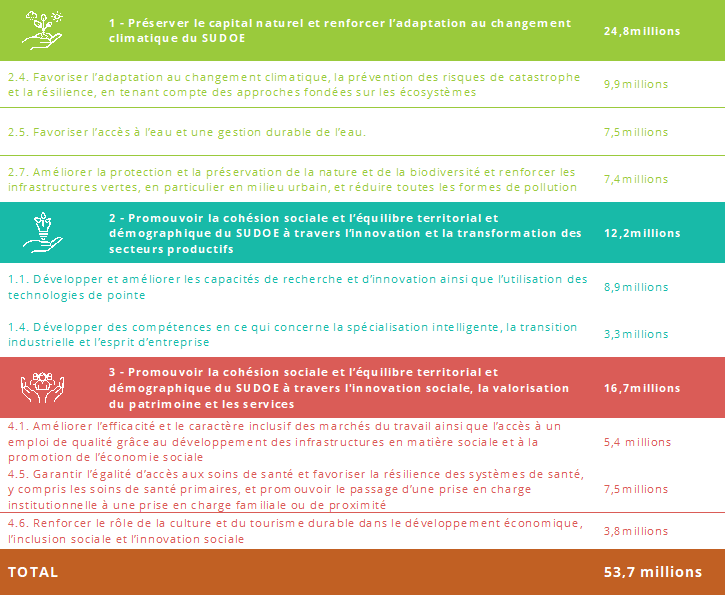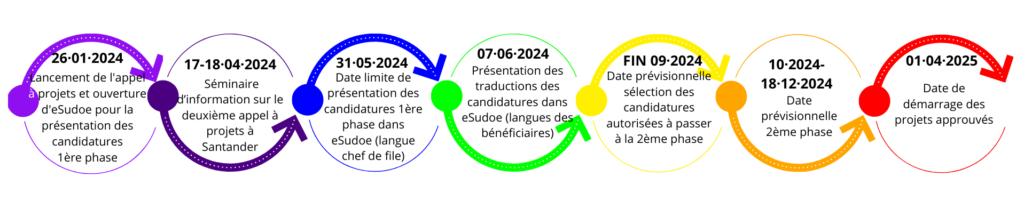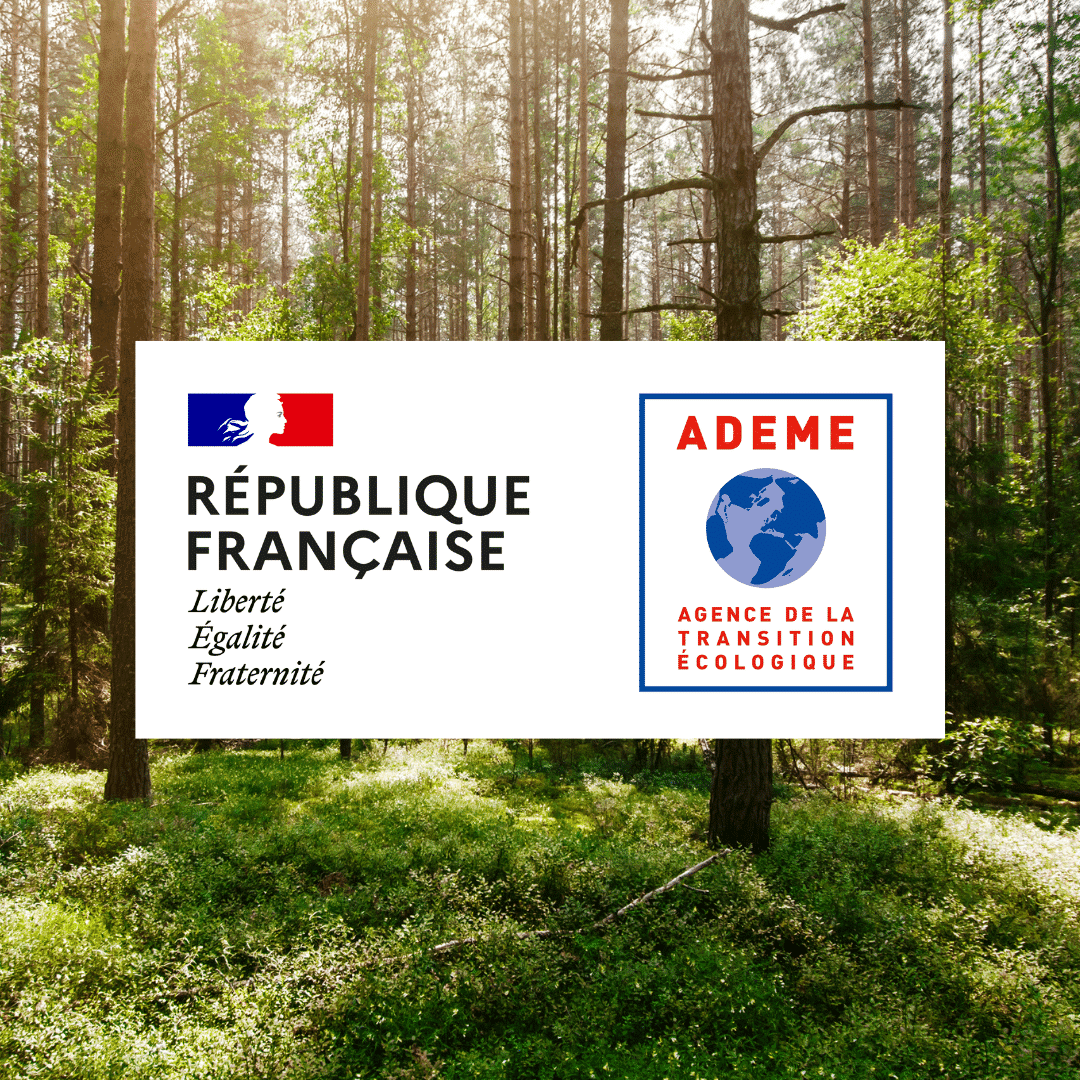Par la rédaction du Lab Alimentation
Du Pays-Basque à l’île de Ré, en passant par le Limousin et la Charente, la région Nouvelle-Aquitaine présente une réelle diversité dans la production de condiments. Piment et sel sous toutes ses formes, safran et même mayonnaise, voici un panorama des condiments de la région.
Le piment d’Espelette, la star du Pays Basque
Sous appellation d’origine protégée depuis 2002, le piment d’Espelette existe sous trois formes différentes : frais, en corde ou en poudre. Sa production s’étend sur 10 communes dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dont le terroir est favorable à la production du piment grâce à l’association de températures douces en été et d’une pluviométrie généreuse. Emblème gastronomique du Pays-Basque, le piment d’Espelette est entré dans bon nombre de ménages français grâce à ses reconnaissances en AOC puis en AOP, et au dynamisme de sa filière qui compte aujourd’hui 207 producteurs, 15 reconditionneurs et 3 transformateurs. On produit chaque année 245 000 tonnes de poudre.
Une mayonnaise de Haute-Vienne obtient un Label Rouge
C’est une actualité toute fraîche : en novembre 2023, la Maison Delouis, entreprise installée dans les Monts de Châlus près de Limoges depuis 1885, a fait certifier sa mayonnaise par un label rouge. Il n’y a que deux mayonnaises industrielles labellisées “label rouge” en France, et celle de Delouis est la seule au rayon épicerie (l’autre mayonnaise labellisée est au rayon frais et suit un cahier des charges différent). Selon Stéphanie Banicic, directrice commerciale de la Maison Delouis, l’entreprise “souhaite faire monter en gamme la mayonnaise industrielle. Le marché est plutôt tiré vers le bas par des produits avec beaucoup d’additifs. Nous voulions donc faire le contraire, et tirer vers le haut la mayonnaise en pot avec une belle qualité organoleptique. Notre mayonnaise est sans additifs, mise sous-vide dans un pot en verre, ce qui permet d’avoir une DLUO de neuf mois.” Si la mayonnaise labellisée n’a que trois mois d’existence, elle semble déjà avoir trouvé un public large parmi la clientèle de Delouis. La concurrence ne devrait pas tarder à imiter l’entreprise limousine dans les années qui viennent.
Le safran de l’Angoumois, un goût d’orient en Charente
Épice luxueuse évoquant l’orient, le safran est également produit en France, notamment dans l’Angoumois où il est cultivé depuis plusieurs siècles. Ils sont aujourd’hui plus d’une dizaine de safraniers à perpétuer un savoir-faire ancestral, un des éléments clefs du safran de l’angoumois selon Guillaume Bouyer, producteur de safran depuis sept ans : “Nous avons un climat doux dans la région qui permet la culture du safran, mais ce sont surtout nos méthodes de culture et de fabrication qui font la particularité de ce bassin.” Le bulbe est planté au plus tard le 15 août, qui germe au 15 septembre pour fleurir au 15 octobre, où le safranier n’a qu’une seule journée pour récolter les pistils de la fleur ; séchés, ces pistils deviennent du safran. Un travail d’orfèvre, long et minutieux, qui donne naissance à une épice rare : pour obtenir un kilogramme de safran, il faut compter 200 000 fleurs. La plupart des safraniers de la région se sont regroupés autour d’une association, « Safran de I’ Angoumois – Champniers Safran » afin de faire rayonner leur produit et de constituer une charte collective en vue d’obtenir potentiellement un signe officiel de qualité type IGP, afin de protéger le safran de l’Angoumois des nombreuses contrefaçons.
Les sels de la région, entre mer et terre
Le 24 novembre dernier, le sel et la fleur de sel de l’île de Ré obtenaient une IGP attendue depuis 2010. Un signe de qualité dont vont profiter les 83 sauniers qui se sont réunis autour d’un collectif pour construire le cahier des charges retenu par l’Union Européenne. Il s’agit du second sel de Nouvelle-Aquitaine reconnu IGP, sept ans après celui de Salies-de-Béarn qui n’est pas un sel marin. En effet, il est obtenu par une évaporation d’eaux souterraines salées selon la méthode ancestrale de la poêle à sel. Le sous-sol de cette région contenant en profondeur des eaux plus salées que l’eau de mer. L’utilisation de ce sel est préconisée dans le cadre de l’IGP Jambon de Bayonne.
En savoir plus…
Le Piment d’Espelette
https://www.pimentdespelette.com/
Un article de l’INAO sur la labellisation de la mayonnaise
https://www.inao.gouv.fr/Nos-actualites/mayonnaise-epicerie-lr
L’association Safran de l’Angoumois, Champniers safran
Un article de notre rédaction sur la labellisation du sel de l’Île de Ré
L’AFPS Producteurs de sel de l’Atlantique
Le Sel Salies-de-Béarn



![[Rédaction du Lab] Panorama des condiments de Nouvelle-Aquitaine](https://www.lab-alimentation-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2024/03/LAB-Gabarits-Centre-de-ressources-28.png)




![[AAP] Le deuxième appel à projets SUDOE est ouvert !](https://www.lab-alimentation-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2022/08/Interreg.jpg)