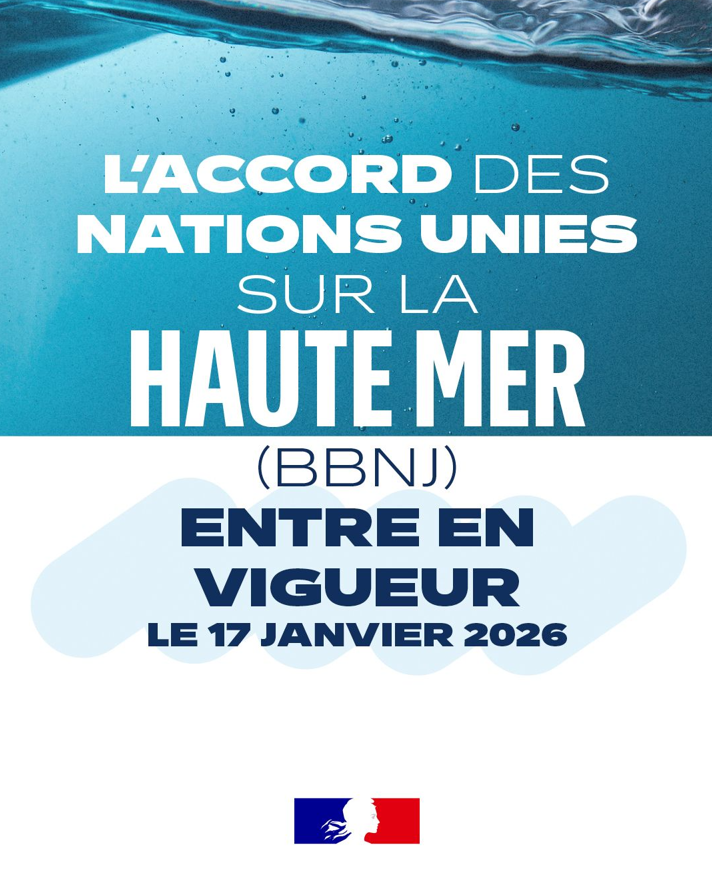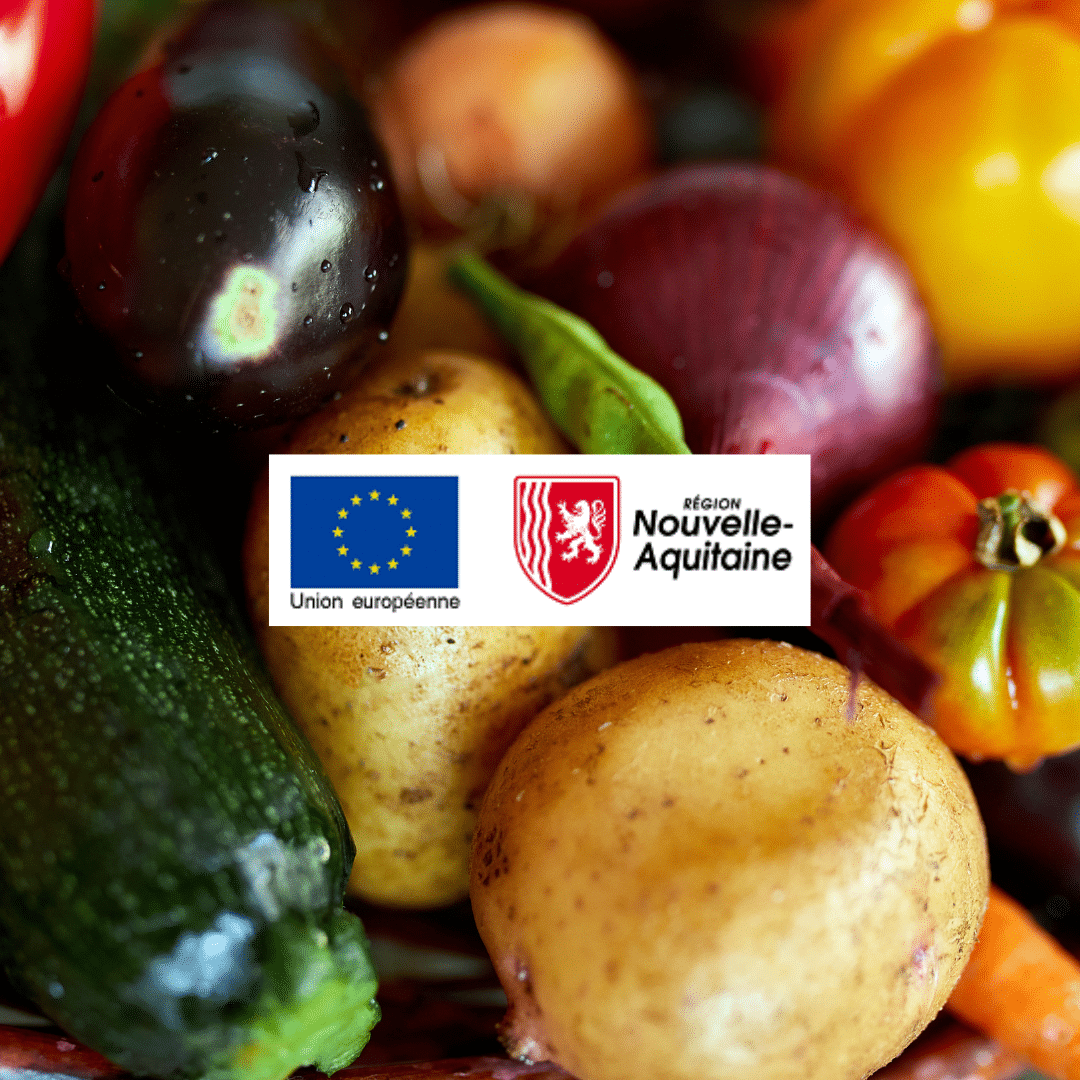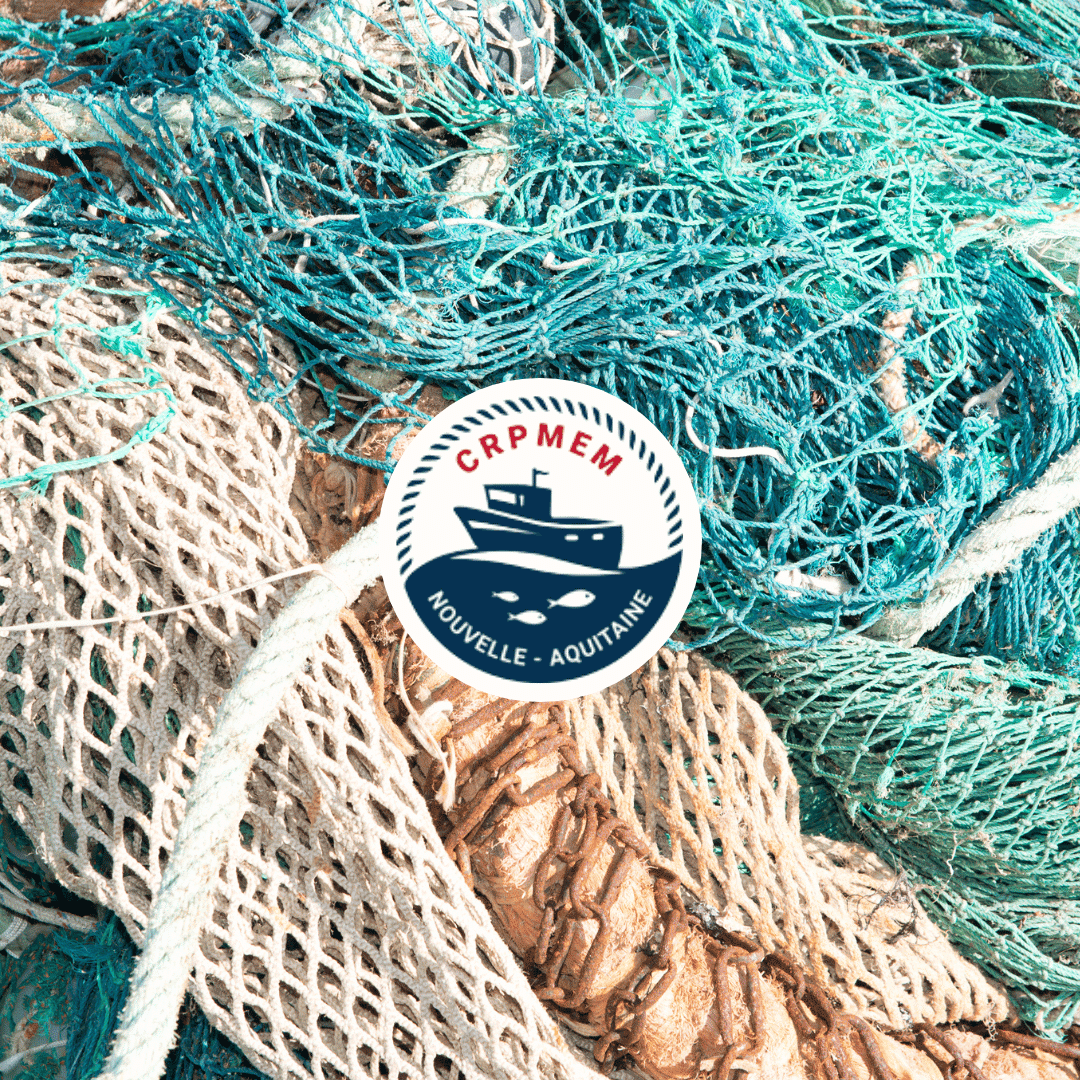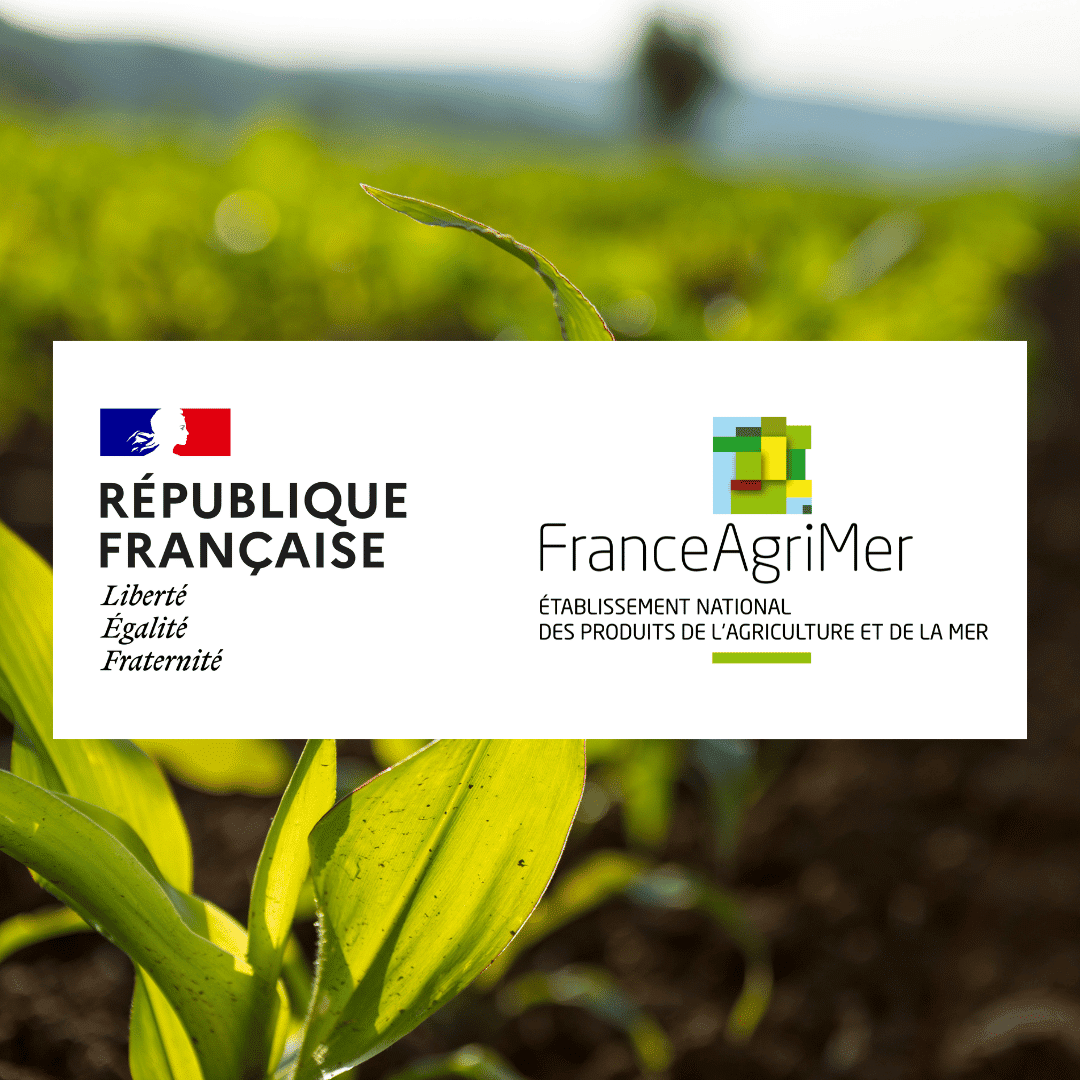L’accord des Nations unies sur la haute mer (BBNJ) entre en vigueur le 17 janvier 2026. Une avancée historique pour la protection des océans et de la biodiversité.
La haute mer représente 60 % de la surface du globe. Avec le BBNJ, ces zones situées au-delà des juridictions nationales sont désormais couvertes par des règles communes de conservation et d’usage durable des milieux marins.
L’accord vient compléter le cadre juridique international de la CNUDM (la Convention des Nations unies sur le droit de la mer). Il permet notamment de mieux protéger les espaces de haute mer grâce à des outils de gestion par zone, comme les aires marines protégées. Il renforce aussi l’encadrement des activités humaines, avec des évaluations d’impact environnemental sur la biodiversité marine. Il instaure également un accès encadré aux ressources génétiques marines et un partage juste et équitable des bénéfices issus de leur utilisation, tout en favorisant le transfert de technologies marines et le renforcement des capacités des pays en développement.
Une victoire collective, portée avec détermination par la France.
Pour aller plus loin : https://www.mer.gouv.fr/laccord-des-nations-unies-sur-la-haute-mer-bbnj
Secteur activité : Pêche et aquaculture
Horizon Europe 2026-2027 : un plan de 14 milliards € pour la recherche, l’innovation et les carrières scientifiques
L’Union européenne a adopté le nouveau programme de travail Horizon Europe pour la période 2026-2027, avec une enveloppe budgétaire indicative de 14 milliards d’euros. Ce programme s’inscrit dans la continuité d’Horizon Europe, principal instrument de financement européen pour la recherche et l’innovation, et vise à renforcer la compétitivité de l’Europe tout en répondant aux grands défis sociétaux, climatiques et technologiques.
Un programme structurant pour la recherche et l’innovation européennes
Horizon Europe 2026-2027 poursuit plusieurs objectifs stratégiques majeurs :
- renforcer l’excellence scientifique européenne et l’attractivité des carrières de recherche ;
- soutenir l’innovation, en particulier dans les secteurs stratégiques pour la souveraineté européenne ;
- accélérer les transitions écologique et numérique ;
- favoriser les collaborations internationales et interdisciplinaires.
Une attention particulière est portée à l’amélioration des conditions de travail et des perspectives de carrière des chercheurs, afin d’attirer et de retenir les talents en Europe.

Une forte ambition environnementale et industrielle
Le programme de travail met l’accent sur la transition écologique, avec une part significative des financements orientée vers des projets contribuant aux objectifs climatiques de l’Union européenne. Les priorités incluent notamment :
- le développement de technologies propres et de solutions bas carbone ;
- la transformation durable des systèmes industriels et alimentaires ;
- l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction de l’empreinte environnementale des activités économiques.
Ces orientations s’inscrivent dans la stratégie européenne visant à concilier compétitivité industrielle et neutralité climatique.
Des dispositifs pensés pour simplifier l’accès aux financements
La programmation 2026-2027 introduit plusieurs évolutions destinées à faciliter la participation des porteurs de projets :
- simplification des appels à projets et réduction de la charge administrative ;
- recours accru aux financements forfaitaires pour alléger la gestion financière ;
- développement d’appels transversaux favorisant les projets collaboratifs entre disciplines, secteurs et territoires.
Ces ajustements visent notamment à encourager la participation des PME innovantes, des nouveaux entrants et des acteurs issus de l’ensemble des régions européennes.
Des thématiques larges et transversales
Horizon Europe 2026-2027 couvre un large spectre de domaines, parmi lesquels :
- climat, énergie et mobilité ;
- industrie, numérique et intelligence artificielle ;
- agriculture, bioéconomie, environnement et ressources naturelles ;
- santé, bien-être et résilience des sociétés européennes.
Cette approche transversale permet de soutenir des projets à fort impact, capables de répondre simultanément à plusieurs enjeux économiques, environnementaux et sociétaux.
Une opportunité majeure pour les acteurs européens
Ce programme constitue une opportunité stratégique pour les organismes de recherche, universités, entreprises, collectivités et structures d’accompagnement souhaitant :
- accéder à des financements européens structurants ;
- intégrer des consortiums internationaux ;
- développer des solutions innovantes à l’échelle européenne ;
- renforcer leur visibilité et leur positionnement sur des marchés en transformation.
Pour en savoir plus sur le programme de travail Horizon Europe 2026-2027 et accéder aux informations officielles, consultez la page dédiée de la Commission européenne :
Appel à projets FEADER – Promotion et développement des filières agricoles de qualité en Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), la Région Nouvelle-Aquitaine lance un appel à projets visant à renforcer la promotion et le développement des filières agricoles de qualité. Ce dispositif s’inscrit dans les objectifs du développement rural et de valorisation des produits agricoles labellisés, en cohérence avec les attentes actuelles des consommateurs et les enjeux économiques des territoires.
Objectif de l’appel à projets
L’objectif principal est d’accroître la notoriété des produits agricoles de qualité de Nouvelle-Aquitaine afin d’augmenter la valeur ajoutée de l’ensemble des filières régionales et, en particulier, des exploitations agricoles. Cette démarche s’appuie sur la valorisation des produits bénéficiant de régimes de qualité reconnus (tels que les signes officiels de qualité et d’origine), répondant à des attentes sociétales en matière de qualité alimentaire, de santé, de durabilité des productions et de bien-être animal.
Types d’actions soutenues
L’appel à projets finance principalement les actions de promotion et de communication visant à renforcer la visibilité des produits de qualité auprès des consommateurs et des acteurs de marché. Les dépenses éligibles sont celles qui sont facturées directement au bénéficiaire, par exemple :
- l’organisation ou la participation à des salons professionnels ou grand public ;
- la mise en place de campagnes de communication sur différents canaux ;
- le soutien à l’animation sur les lieux de vente ou lors d’événements ;
- la production de goodies ou de produits de dégustation ;
- le financement de la conception ou de la refonte d’un site internet non marchand.
Ces types d’actions permettent aux porteurs de projets de diffuser efficacement l’image et les spécificités de leurs produits en ciblant des publics clés.
Publics éligibles
L’appel à projets s’adresse à des structures collectives représentatives des filières ou des systèmes de qualité, notamment :
- les organismes de défense et de gestion (ODG) des signes officiels de qualité et d’origine,
- les interprofessions en lien avec un régime de qualité reconnu,
- les groupements réunissant majoritairement des opérateurs de l’agriculture biologique.
Cette ouverture vise à encourager des actions collectives structurées, capables de maximiser l’impact de la promotion au niveau régional, national ou international.
Calendrier et dépôt des dossiers
Cet appel à projets fait partie de la programmation FEADER 2023-2027 mise en œuvre par la Région Nouvelle-Aquitaine. Les porteurs intéressés doivent respecter les dates de dépôt des candidatures et utiliser la plateforme dématérialisée dédiée pour soumettre leurs dossiers, accompagnés des pièces requises (formulaire de demande d’aide, prévisionnel de dépenses, etc.).
L’accompagnement de projets structurants en matière de promotion des produits agricoles de qualité s’inscrit dans la stratégie régionale de soutien aux filières agricoles et agroalimentaires, en renforçant leur compétitivité et leur accès à des marchés plus larges.
Pour consulter directement la description complète de l’appel à projets et accéder au dossier de candidature, rendez-vous sur la page officielle de l’appel à projets FEADER :
Guide des fonds FEDER/FEDER SFE / FEAMPA
Vous êtes une entreprise, une association, une collectivité … et vous souhaitez mobiliser le FEDER pour financer votre projet sur le territoire métropolitain ? Ce guide vous est destiné :
Bulletin de veille – Octobre 2025
CRPMEM Nouvelle–Aquitaine : Note de conjoncture régionale du secteur des pêches maritimes – 1er semestre 2025
Comme chaque année, le CRPMEM Nouvelle-Aquitaine édite une note de conjoncture régionale du secteur de la pêche maritime et estuarienne.
La Gazette de l’AANA – octobre 2025
Chaque trimestre, retrouvez la lettre d’information de l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine :
Les Nouvelles Fermes lèvent 5 millions d’euros pour accélérer leur développement en Île-de-France
La start-up bordelaise Les Nouvelles Fermes franchit une nouvelle étape dans son expansion : grâce à une levée de fonds de 5 millions d’euros, l’entreprise s’apprête à bâtir la plus grande ferme d’aquaponie d’Europe, à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines.
Un modèle circulaire inspiré du vivant
Fondée en 2019, la société repose sur un système agricole innovant : l’aquaponie. Cette méthode combine l’élevage de poissons et la culture de légumes en un circuit fermé et économe en ressources.
Concrètement, des truites arc-en-ciel sont élevées dans des bassins. Leurs déjections, une fois filtrées biologiquement, servent à nourrir des cultures maraîchères, cultivées sous serre, les racines directement plongées dans l’eau. Ce procédé réduit considérablement la consommation d’eau (×10) et limite l’usage d’énergie (÷5) par rapport à des productions classiques en plein champ.
Autre avantage : ces fermes peuvent s’implanter sur des terrains jusqu’ici inutilisables, car imperméabilisés ou pollués.
Une croissance rapide et structurée
L’aventure débute à Lormont, près de Bordeaux, avec une première ferme de 1 000 m². En 2022, l’équipe inaugure un second site à Mérignac, cinq fois plus vaste. Ce lieu permet à la start-up de renforcer son expertise technique, agronomique et piscicole.
Aujourd’hui, un nouveau cap est franchi avec un chantier de 2 hectares lancé en région parisienne. L’objectif : produire chaque année 250 tonnes de fruits et légumes, et 60 tonnes de poissons en local. Pour accompagner cette montée en puissance, une vingtaine de recrutements sont prévus sur le site francilien.
Un lien à recréer entre ville et agriculture
Les Nouvelles Fermes ambitionnent de rapprocher production alimentaire et territoires urbains. « L’aquaponie, c’est avant tout du bon sens », résume Thomas Boisserie, cofondateur. Au-delà de la performance environnementale, leur démarche vise à réconcilier agriculteurs et citadins, autour d’une alimentation saine, locale et transparente.
Ouverture au public et vente directe
Le site de Mérignac joue aussi un rôle pédagogique. Il sera ouvert à la visite le 18 octobre (sur réservation, 6 €), avec dégustation à la clé. Par ailleurs, des ventes directes ont lieu tous les mercredis et samedis matin, et un service de commandes en ligne avec livraison en point relais est proposé aux particuliers.
Pêche durable en Nouvelle-Aquitaine : préserver les ressources pour demain
La Nouvelle-Aquitaine s’impose comme un territoire phare pour la pêche durable. Entre pratiques responsables, contrôle de la qualité de l’eau et coopération avec les laboratoires scientifiques, la région renforce à la fois la compétitivité et la durabilité de ses filières maritimes. Première région agricole et agroalimentaire de France et d’Europe, elle dispose également d’un littoral riche en ressources marines, véritable atout pour l’avenir des entreprises de la pêche et de la conchyliculture.
Trier sa pêche, une pratique essentielle à la durabilité
Respecter la taille minimale de capture des poissons, céphalopodes et coquillages est une règle incontournable pour assurer la reproduction des espèces. Les individus trop petits doivent être relâchés, garantissant ainsi le renouvellement des ressources.
Comme le rappelle un professionnel : « Chaque capture doit être pensée pour demain. C’est la condition de survie de nos métiers et de la biodiversité marine ».
La qualité de l’eau, enjeu stratégique pour la filière
La qualité des eaux littorales conditionne directement la sécurité sanitaire des produits et la pérennité des marchés. Si les pollutions visibles, comme les marées noires, marquent les esprits, les pollutions invisibles (bactéries, toxines) constituent souvent le risque le plus critique.
En Nouvelle-Aquitaine, une surveillance rigoureuse est mise en place afin de garantir la conformité sanitaire, renforcer la confiance des consommateurs et maintenir la compétitivité de la filière.
Pêcheurs et scientifiques, une coopération pour la traçabilité
Les professionnels participent activement aux dispositifs de suivi, notamment au sein du réseau Refi (Réseau de surveillance microbiologique). Des prélèvements réguliers permettent de détecter :
- la présence de toxines dans les coquillages,
- des bactéries indicatrices comme Escherichia coli.
Les moules, considérées comme des coquillages sentinelles, jouent un rôle clé. En cas de seuil critique, des mesures immédiates sont prises : contrôles renforcés, analyses complémentaires et, si nécessaire, fermeture temporaire de la pêche.
Cette coopération illustre l’intégration croissante des pêcheurs dans la recherche scientifique et la traçabilité sanitaire.
Durabilité et compétitivité : un modèle collectif
La pêche responsable n’est pas seulement un impératif écologique, elle constitue aussi un facteur de compétitivité pour les entreprises. La sécurité alimentaire et la traçabilité sont devenues des critères décisifs pour accéder aux marchés nationaux et internationaux.
En collaborant avec les scientifiques, les pêcheurs sécurisent leurs débouchés, anticipent les évolutions réglementaires et renforcent l’image d’une pêche régionale durable et responsable.
Nouvelle-Aquitaine, un territoire engagé pour la pêche responsable
Le modèle développé en Nouvelle-Aquitaine repose sur trois leviers :
- Préserver les stocks grâce à des pratiques de capture responsables.
- Surveiller la qualité de l’eau pour protéger consommateurs et écosystèmes.
- Travailler collectivement entre professionnels, filières et scientifiques.
Ce triptyque permet d’inscrire la région dans une dynamique où économie et écologie avancent ensemble, garantissant la durabilité de la pêche et de la conchyliculture.
Les performances à l’exportation des filières agricoles et agroalimentaires françaises pour l’année 2024
Export agroalimentaire français en 2024 : performances contrastées et résilience sectorielle
En 2024, les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires ont affiché une hausse modérée malgré un contexte international instable, marqué par des tensions géopolitiques, l’inflation des coûts logistiques et la volatilité des matières premières.
- Excédent commercial agroalimentaire : L’excédent se maintient autour de 10 milliards d’euros, consolidant la place de la France comme acteur majeur du commerce mondial de produits agricoles transformés et bruts.
- Filières en progression :
- Vins et spiritueux : malgré un ralentissement aux États-Unis, les marchés asiatiques (Chine, Corée du Sud) affichent une progression notable.
- Produits laitiers : forte dynamique vers l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud-Est.
- Céréales : volumes importants à l’export grâce à une bonne récolte et une demande soutenue du Moyen-Orient.
- Filières en difficulté :
- Fruits et légumes frais : compétitivité toujours affaiblie par les coûts de production élevés.
- Viandes : recul vers certains marchés européens, impacté par les normes sanitaires et la concurrence intra-européenne.
- Zoom Nouvelle-Aquitaine : les produits phares comme les vins de Bordeaux, les conserves, ou les produits transformés de la mer continuent de porter les exportations régionales, avec un accent croissant sur la montée en gamme et la traçabilité.